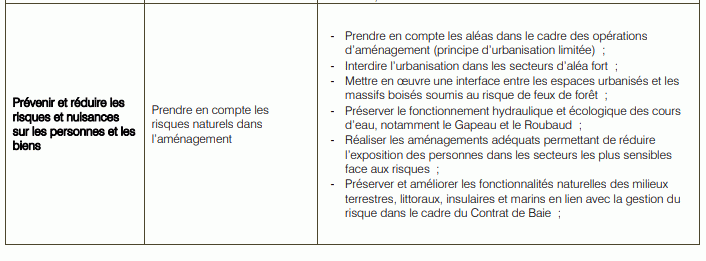Préconisations de rédaction PLU(i) – PADD – Réduction du risque inondation
Publié le 25 avril 2023 - Mis à jour le 21 septembre 2023
- Thématiques
- Prévenir les risques naturels
- Étapes
- PADD
- Quelle traduction stratégique dans mon projet ?
- Document d’urbanisme
- PLU(i)
Dispositions du SDAGE & PGRI
1.1.3. SDAGE Protéger les milieux humides et les espaces contribuant à limiter le risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou par submersion marine dans les documents d’urbanisme (Disposition commune 1.C.1 PGRI)
1.2.1. SDAGE Cartographier et préserver le lit majeur et ses fonctionnalités (Disposition commune 2.C.1 PGRI)
4.2.3. SDAGE Elaborer une stratégie et un programme d’actions limitant les ruissellements à l’échelle du bassin versant (Disposition commune 2.E.2 PGRI)
5.5.3. SDAGE Adopter une approche intégrée face au risque de submersion (Disposition commune 1.C.1, 2.A.2, 2.D.1, 2.D.2, 2.D.3 PGRI)
1.A.1. PGRI Comment évaluer la vulnérabilité d’un territoire aux inondations
1.A.3 PGRI Intégrer dans le PLU et les documents en tenant lieu, des communes ou leurs groupements en priorité dans les territoires couverts par un TRI, un diagnostic de vulnérabilité de territoire aux inondations et évaluer les incidences de sa mise en œuvre
1.A.5 PGRI Suivre la réalisation des diagnostics de vulnérabilité de territoire aux inondations
1.A.6. PGRI Réduire la vulnérabilité aux inondations des territoires dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain
1.B.1. PGRI Prioriser les diagnostics de vulnérabilité aux inondations à mener (quartiers, bâtiments, et activités économiques)
1.B.8. PGRI Prendre en compte la réduction de la vulnérabilité aux inondations dans les programmes locaux de l’habitat (PLH), en particulier dans les secteurs à enjeux
1.C.2. PGRI Encadrer l’urbanisation en zone inondable
1.C.3 PGRI Encourager dans les territoires à risque important d’inondation (TRI) les réflexions portant sur la planification du territoire résilient aux inondations qui peuvent aller jusqu’à la recomposition spatiale du territoire
4.B.1. PGRI Poursuivre l’amélioration de la connaissance des enjeux exposés aux inondations
ATTENTION ! Le document d’urbanisme doit se référer systématiquement aux SAGE du territoire lorsqu’ils existent, ceux-ci peuvent décliner des dispositions et règles propres aux enjeux du territoire.
Les préconisations de rédaction
Détailler la stratégie de réduction des risques d’inondation
Pour réduire les risques d’inondation, il convient :
- de ne pas ouvrir à l’urbanisation les zones inondables non urbanisées : prise en compte de l’aléa de référence pour la détermination des interdictions ou limitations
- de limiter l’urbanisation dans les zones inondables urbanisées : une ouverture à l’urbanisation peut créer de nouveaux enjeux face aux risques d’inondation (augmentation du risque et/ou de la vulnérabilité), en particulier si les caractéristiques de tout ou partie de la zone à urbaniser jouent une fonction hydraulique. Lorsqu’on urbanise, on augmente la vulnérabilité des biens et des personnes face au risque. Intégrer l’objectif de non-aggravation des risques inondation revient ainsi à limiter l’impact de l’urbanisation sur la vulnérabilité des biens et des personnes.
- d’agir pour la réduction de la vulnérabilité des secteurs urbanisés : en améliorant la connaissance en matière de risque d’inondation (diagnostics de vulnérabilité aux inondations notamment), encadrement de l’urbanisation en zone inondable (garantir la résilience des nouvelles constructions ; principe de neutralité hydraulique de l’aménagement…), protéger les espaces contribuant à limiter le risque d’inondation…
En milieu rural, des principes d’aménagement et d’utilisations du sol permettant de renforcer la lutte contre l’érosion des sols et les phénomènes de coulées de boues peuvent également être intégrés : études à mener à l’échelle du bassin versant pour déterminer les axes d’écoulement et augmenter les capacités d’infiltration et de stockage des sols, notamment à l’occasion des procédures d’aménagement foncier des territoires ruraux, (intérêt des petites parcelles, des haies, des mares, talus, retenues collinaires, fossés, bandes enherbées…).
Privilégier les solutions fondées sur la nature pour agir sur l’aléa
Pour agir sur l’aléa inondation, l’appui de milieux naturels/de solutions fondées sur la nature est l’option durable à privilégier dans les choix d’aménagements futurs. Les principes, orientations et objectifs d’une urbanisation adaptée à la réduction du risque inondation et d’aménagement s’appuyant sur le fonctionnement naturel des milieux doivent figurer dans le PLU(i).
Le PADD doit être compatible avec l’objectif de préservation des espaces contribuant à limiter le risque d’inondation par débordement de cours d’eau (zones d’expansion des crues, etc.) ou par submersion marine (cordons dunaires et leur espace de mobilité, cordons de galets, zones estuariennes, lagunes, marais rétro-littoraux, prés-salés, etc.). Il veille à intégrer une stratégie visant à :
- restaurer les annexes hydrauliques qui permet de gérer de manière durable et raisonnée les inondations en favorisant le stockage des eaux dans le lit majeur (Cf. Fiches sur les Zones humides) ;
- restaurer les zones naturelles d’expansion de crues qui permet d’orienter les crues, remontées de nappe et phénomènes de ruissellement vers une zone où le milieu va pouvoir « absorber » naturellement l’excédent d’eau (en la stockant temporairement, en l’aidant à s’infiltrer…) ;
- favoriser le ralentissement dynamique des écoulements qui permet de diminuer le risque d’inondation par des aménagements venant contenir temporairement les eaux, partout où cela est possible et avant qu’elles n’aient atteint une importante vitesse d’écoulement (étaler dans le temps les volumes transitant par les rivières).
Dans cette optique, la préservation et la restauration des milieux naturels et des éléments de paysage sur les axes d’écoulements (Voir Fiches sur les Eléments fixes du paysage) font partie des actions visant à mieux gérer les débordements. En particulier, la préservation et de restauration du fonctionnement naturel des cours d’eau (Voir Fiches sur la Renaturation des cours d’eau), la gestion des zones humides, des prairies et fossés ayant une fonctionnalité hydraulique identifiée, contribuent à la prévention et à la limitation des effets des inondations. Des opérations de restauration ou de réhabilitation sont à prévoir le cas échéant pour en améliorer la fonctionnalité (comme la suppression de merlon de curage pour reconnecter le lit mineur au lit majeur du cours d’eau).
Les exemples de rédaction
-
PLUi de l’Agglomération d’Agen (Lot-et-Garonne, 47) – Révision approuvée en 2017
« 8.2 Intégrer les aléas naturels et protéger les populations vis-à-vis des risques
- La révision du PLUi s’inscrit dans un contexte d’évolution et de forte extension des cartographies d’aléas d’inondation et de mouvements de terrain sur la plus grande partie du territoire de l’Agglomération. Ces cartographies d’aléas, débouchant sur des plans de prévention des risques (PPR) renouvelés, sont déterminantes sur les choix faits dans le PLUi dans beaucoup de territoires communaux, tant dans la plaine de Garonne que sur les coteaux, et impactent de ce fait les stratégies urbaines définies pour l’ensemble de l’Agglomération. Ces aléas et leurs conséquences potentielles en termes de risques seront ainsi pris en compte :
- en appliquant un principe d’inconstructibilité sur les espaces non bâtis d’aléas forts d’inondation, les espaces d’aléas forts de glissements, d’effondrements de terrains ou de chutes de pierres, et les espaces d’expansion des crues,
- en limitant les développements bâtis dans les espaces d’aléas moyens de mouvements de terrains,
- Dans ce contexte, il est également nécessaire que l’Agglomération et ses communes soient parties prenantes dans la définition des zones de risques et de leurs futures règlementations :
- d’une part, pour s’assurer que la prise en compte de ces aléas naturels soit conciliée avec les enjeux d’évolution du bâti existant dans les centres et les quartiers déjà bien constitués, en termes de possibilité de rénovation, de reconstruction, d’extension ou de changement d’usage de ce bâti,
- d’autre part, dans une perspective de définition de projets d’aménagement et de rénovation urbaine intégrant la réduction de la vulnérabilité au risque inondation.
- Des stratégies locales de gestion des inondations seront élaborées et mises en œuvre, dans le cadre du PAPI (Programme d’actions et de prévention des inondations) du bassin du Bruilhois et de la Stratégie Locale de Gestion des inondations du TRI d’Agen. Ainsi, la localisation d’ouvrages destinés à écrêter les crues, et à supprimer ou réduire leurs incidences en aval dans les zones urbanisées, sera définie et traduite dans le PLUi.
- Le programme de protection de l’Agglomération contre les crues et d’amélioration de la gestion des ouvrages de protection sera poursuivi et finalisé, en menant une réflexion sur une gestion globale de l’ensemble des digues du territoire.
- Le projet veillera à gérer les capacités d’écoulement et à mettre en œuvre les principes de ralentissement dynamique, par :
- la protection des zones humides et végétales qui contribuent au ralentissement des écoulements,
- la maîtrise des ruissellements urbains, en privilégiant un principe de gestion sur l’assiette même des opérations, et en encourageant à la récupération et réutilisation des eaux pluviales.
- l’entretien des cours d’eau pour permettre l’écoulement naturel des eaux. »
Référence :
Voir PLUi de l’Agglomération d’Agen, PADD, p. 50
PLU d’Hyères (Var, 83) – Approuvé en 2017
Référence :
Voir PLU d’Hyères, PADD, p. 11
- La révision du PLUi s’inscrit dans un contexte d’évolution et de forte extension des cartographies d’aléas d’inondation et de mouvements de terrain sur la plus grande partie du territoire de l’Agglomération. Ces cartographies d’aléas, débouchant sur des plans de prévention des risques (PPR) renouvelés, sont déterminantes sur les choix faits dans le PLUi dans beaucoup de territoires communaux, tant dans la plaine de Garonne que sur les coteaux, et impactent de ce fait les stratégies urbaines définies pour l’ensemble de l’Agglomération. Ces aléas et leurs conséquences potentielles en termes de risques seront ainsi pris en compte :
-
PLU de Bordeaux Métropole (Gironde, 33) – Révision approuvée en 2016
« 2.2.3. Prendre en compte l’importance de l’eau dans le territoire (le fleuve, les cours d’eau, les zones humides, les zones inondables et les eaux de ruissellement)
Le PLU prendra en compte la présence de l’eau et les risques inondations dans la stratégie d’aménagement en adoptant des modalités de développement et de gestion différenciées suivant le niveau d’équipements et de services et le niveau de l’aléa des secteurs concernés, de façon à réduire la vulnérabilité du territoire.
- Restitution d’un espace d’expansion aux fleuves et aux cours d’eau, en assurant la libre circulation de l’eau dans les zones non habitées ou très peu denses. […] »
Référence :
Voir PLU de Bordeaux Métropole, PADD, p.16