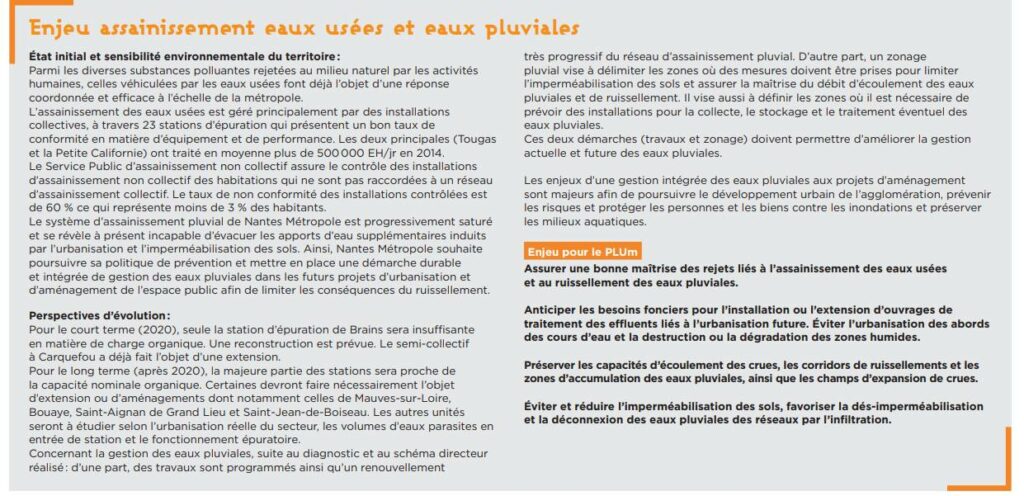Préconisations de rédaction PLU(i) – Rapport de présentation – Assainissement et développement de l’urbanisation
Publié le 25 avril 2023 - Mis à jour le 13 juin 2023
- Thématiques
- Prendre en compte la capacité des équipements et milieux
- Étapes
- Quel diagnostic sur mon territoire ?
- Rapport de présentation
- Document d’urbanisme
- PLU(i)
Disposition du SDAGE
4.1.3 SDAGE Concilier aménagement et disponibilité des ressources en eau dans les documents d’urbanisme
ATTENTION ! Le document d’urbanisme doit se référer systématiquement aux SAGE du territoire lorsqu’ils existent, ceux-ci peuvent décliner des dispositions et règles propres aux enjeux du territoire.
Les préconisations de rédaction
Etablir un état des lieux en matière d’assainissement
Il s’agit de s’intéresser aux modes de gestion des eaux usées sur le territoire : assainissement collectif ou non collectif, état des réseaux de collecte unitaires ou séparatifs, taux de collecte et conformité des branchements, performances de dépollution, dysfonctionnements éventuels constatés notamment liés aux surcharges (hydrauliques et / ou polluantes) des équipements, sensibilité des milieux récepteurs, dont ceux pour lesquels des flux maximum admissibles peuvent avoir été définis, etc.). Cet état des lieux doit tenir compte des risques liés au changement climatique.
En savoir plus
Où trouver ces données ? Voir Fiche « Données, diagnostics & études »
Analyser la capacité des dispositifs d’assainissement du territoire
Il s’agit de croiser la capacité des dispositifs d’assainissement du territoire avec les rejets supplémentaires induits par les nouveaux habitants, les variations de population saisonnière et les activités supplémentaires. Une évaluation des rejets futurs et de leur adéquation avec la sensibilité des milieux récepteurs et leurs débits projetés dans le contexte du changement climatique doit être menée (selon la disposition 3.3.2 du SDAGE, la baisse des débits d’étiage est estimée à 10% d’ici 2030, 30% d’ici 2060).
Les exemples de rédaction
-
PLUi de l’Agglomération d’Agen (Lot-et-Garonne, 47) – Révision approuvée en 2017
Dans le rapport de présentation (état initial de l’environnement et évaluation environnementale), les différents milieux récepteurs sont caractérisés par leur état écologique et chimique, les objectifs d’atteinte du bon état définis par le SDAGE et les enjeux quantitatifs. Une présentation détaillée des modalités d’assainissement est effectuée à partir des données produites par l’Agglomération, le SATESE 47 et la DDT 47 : descriptif des 29 stations d’épuration avec leur niveau de conformité, les charges (hydrauliques et organiques reçues), les dysfonctionnements constatés, les travaux prévus, et au final une appréciation de la capacité résiduelle de traitement. Cela permet de conclure sur la cohérence globale du projet d’accueil de l’agglomération (10 700 habitants supplémentaires à échéance du PLUi) avec les capacités des équipements.
Référence :
Voir Agence de l’eau Adour-Garonne, « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 100
PLUm de Nantes Métropole (Loire-Atlantique, 44) – Approuvé en 2019
Référence :
Voir PLUm de Nantes Métropole, Rapport de présentation, Tome 1, p. 77
PLUi-HD du Grand Chambéry (Savoie, 73) – Approuvé en 2019
« Le secteur de Chambéry métropole compte 8 stations d’épuration dont la plus importante est localisée à Chambéry. […] Elles font toutes état d’une conformité réglementaire. L’assainissement collectif du Cœur des Bauges est réalisé par 12 stations d’épuration réparties sur le territoire, reliées par un réseau de type unitaire et séparatif. Parmi les ouvrages d’épurations, 8 stations sont de type filtre planté de roseaux, de capacités variant de 130 EH à 800 EH. Des dysfonctionnements sont constatés sur des ouvrages d’épuration, […]
Les capacités épuratoires du territoire sont globalement suffisantes pour accueillir les consommations domestiques des nouveaux habitants à l’horizon 2030. Le secteur Cœur des Bauges est le plus problématique, puisqu’il devrait arriver en limite de ses capacités épuratoires à l’horizon 2030 et a déjà des problèmes de conformité. Toutefois, les consommations des activités autres que domestiques ne sont pas prises en compte.
Taux de conformité des dispositifs individuels
Des installations sources de pollution des milieux naturels
Une part importante du territoire du Cœur des Bauges est en assainissement non collectif, plus adapté à l’habitat dispersé des hameaux. Sur l’ensemble des dispositifs d’ANC, seulement 29% sont recensés conformes (soit 266 installations)… La non-conformité des dispositifs entraine une pollution bactériologique progressive sur les milieux naturels. Plusieurs points noirs ont été identifiés lors du diagnostic du schéma directeur d’assainissement, principalement lié à la configuration géographique pour l’accueil de systèmes d’assainissement non collectifs (exiguïté) : le Pont de la Compôte, le chef-lieu d’Aillon-le-Vieux, secteurs du Châtelard, hameaux de Jarsy… En outre, de nombreux bâtiments d’activités ne disposent pas de prétraitement, et plusieurs effectuent des rejets directs dans le milieu naturel. Dans le secteur de Chambéry Métropole, un SPANC a été mis en place en 2006. Sur 2 261 installations d’assainissement non collectif 978 ont été diagnostiquées, avec un taux de conformité de 31% (données de 2016). Une opération collective est en cours depuis 2004, qui a déjà permis la mise en conformité de 400 installations. Au niveau global, le diagnostic a recensé 20% des installations pouvant présenter un risque. »
Référence :
Voir PLUi-HD du Grand Chambéry, Rapport de présentation, Tome 1 : Diagnostic de territoire et état initial de l’environnement, p. 128-129
PLUi du Grand Rodez (Aveyron, 12) – Révision approuvée en 2017
« La Communauté d’Agglomération a souhaité une étude approfondie sur les potentialités d’urbanisation du territoire au regard de l’assainissement collectif des eaux usées pour en mesurer les incidences économiques et techniques. Cette étude effectuée par IDE Environnement a permis de mettre en avant les difficultés prévisionnelles sur le réseau d’assainissement collectif des eaux usées et plus particulièrement au niveau des ouvrages d’épuration et des postes de relevage : des zones à urbaniser isolées de tout bassin versant d’assainissement, des stations d’épuration en surcharge, des travaux de rénovation/extension nécessaires. Cette étude a apporté des éléments complémentaires en matière d’analyse du maintien ou non de certaines zones à urbaniser, de suppression du zonage collectif les zones à urbaniser isolées de tout bassin versant d’assainissement, de phasage de travaux à mener sur les équipements pour absorber l’accroissement de population. »
Référence :
Voir PLUi du Grand Rodez, Rapport de présentation, Diagnostic, p. 62